… la revue Europe consacre un article, (centenaire ce mois-ci) , à la poétesse de langue anglaise Frédégonde Shove
« un poète* encore peu connu dans son propre pays«
__
* Le texte original de Francis Birrel est en anglais, dans sa traduction Betty Collin choisit ce mot.
(à l’écoute par anticipation d’Emmanuel Macron … « en français, le masculin c’est le neutre« )
Ce qu’apprécie particulièrement Francis Birrel, sont des qualités qu’il considère comme parfaitement adaptées au genre féminin.
Son œuvre, jusqu’à présent, est rare et délicate. Elle possède, à un degré infini, ces deux qualités féminines qui ont favorisé la civilisation : la bonne éducation et la modestie. Sa voix est toujours douce, lente, chose excellente pour une femme.
Au-delà de cette condescendance, l’auteur de l’article évoque les raisons du manque de notoriété de la poétesse (un monde d’homme) ainsi que les qualités de ses vers.
Sa tendre voix a été couverte par les hennissements de tous les étalons de la poésie ; son œuvre, jusqu’à présent, est rare et délicate.
…
Comment, dans ces conditions, eût-elle gagné-une notoriété à notre époque de journalisme ?
Elle est romantique, parce que son art est très subjectif :
A la plainte du mélèze et du sapin
et du lierre, au printemps,
ai-je ajouté quelque chose
de la révolte instinctive de ma vie ?
Francis Birrel a beaucoup de sympathie pour la poétesse, il le dit dans la fin de l’article, mais c’est une affection paternelle qui le lit à Frédégonde Shove, il n’utiliserait pas ces expressions (en gras ci-dessous) pour un homme, à moins qu’il s’agisse d’un tout jeune adolescent, s’essayant à l’écriture, non sans talent, mais celui, naïf et ayant l’expression de premier degré, des débutants.
C’est sa spontanéité qui fait sa valeur, comme ce fut le cas, avant
elle, pour Wordsworth et Christina Rossetti.**
La sensibilité de Mrs Shove est si grande que son sommeil est troublé par bien des choses. On se la représente facilement éveillée pendant la nuit, et se lamentant, dans son innocence, sur les misères du monde et sur ses propres péchés.
Chétive Misère est une petite enfant
avec des engelures aux mains et aux pieds.
Assez curieux, je trouve, qu’elle m’ait souri
quand je passais près d’elle dans la rue !
Oh ! quel démon je dois être
pour que Misère puisse me sourire !
Elle même un peu crédule, à la manière d’un enfant (ici elle ne « pense pas que », elle « croit ») et sa tristesse est sans réserve, sans ce voile qui chez le poète produit le vers sublime.
Mais elle est profondément chrétienne.
Elle croit que son âme, comme celle de chacun, contient une
force orientée vers la vertu et que le monde, malgré sa méchanceté et
sa terrible puissance, ne peut arriver à corrompre.
Dans un de ses poèmes les plus parfaits et que je voudrais citer en
entier, elle décrit avec une claire tristesse, – qui nous ramène à Vaughan
ou à Crashaw, – la lutte mystique de l’âme humaine :
LE ROYAUME DES CIEUX
Tu es en moi comme un coquillage
au fond d’un étang ;
ou comme une herbe-au-lait au sein de l’enfer,
si fraîche, si douce ;
ou comme un glaçon tout transparent
et tout poli à l’intérieur
miroir de piété; et pur
mépris du péché -.
Et autour de toi j’ai construit
une forteresse,
un château dont les murs épais sont cachés, ‘
si fier, si fort ;
et maintes chambres, où je marche,
si forte, si fière,
et maints salons, où je parle
tant, et si haut.
Mais quand tout s’écroulera dans la flamme de l’enfer,
si prompte, si ardente,
mon cœur restera là, le même,
mon cœur, un chant.
Je ne serai plus, ni tous mes actes,.
mes haines, mes colères, et leur semence,
disparaîtront.
Tu es au cœur de la tempête, et tu es
si bien gardée, et si calme l
O Jésus du cœur humain,
que nul ne peut tuer !
Dans les derniers mots de l’article on retrouve ces deux expressions du jugement de l’auteur !
Je suis peut-être tenté de surestimer son talent, parce que je le trouve
fort sympathique.
…
Son œuvre se réduit jusqu’ici à deux petits volumes :
Dreams and Journeys
Daybreak
si bien que l’effort de la lire …
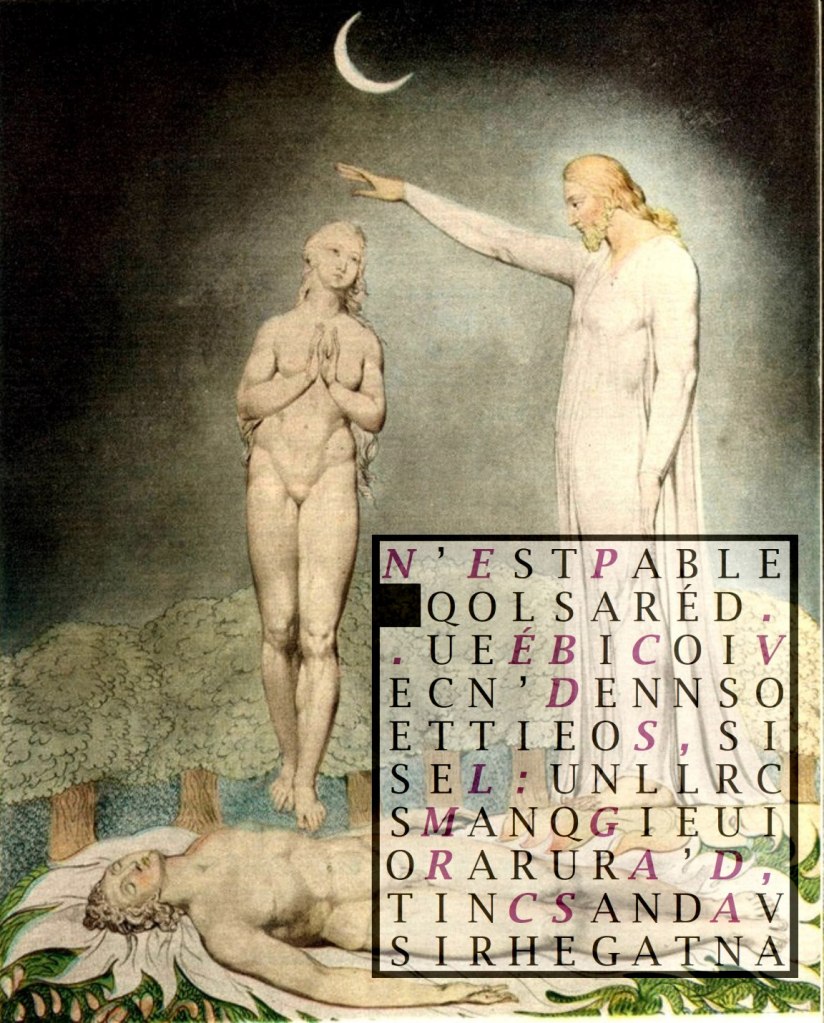
(Pour lire la grille plus facilement, cliquer ici)
** Frédégonde Shove publiera en 1931 une étude sur Christina Rosseti qui sera évoquée dans la « Revue de l’enseignement des langues vivantes ».
F.C. Danchin (traducteur) fait preuve lui aussi dans son article, à travers ses propos, d’une attitude (a minima paternaliste) qui ne serait pas apprécié de nos jours.
— si Miss Shove ne présente pas la poétesse sous un jour nouveau, ce qui serait assez difficile
vu la limpidité un peu grêle de ses vers, elle sait définir le charme aimant et délicat et chrétien de cette poésie, elle sait aussi y découvrir* un filet d’humour que les critiques n’ont point toujours aperçu et que M. Cazamian lui-même, dans deux pages très nuancées de la Littérature Anglaise, ne parait pas avoir remarqué.
Miss Shove s’attaque ensuite au sujet moins connu de la prose de Christina Rossetti, moins riche en aperçus de nature, moins spontanée, guindée même et qui justifie M. Cazamian d’avoir employé les mots
« austérité religieuse » en parlant de l’œuvre entière.
Enfin un dernier chapitre replace l’auteur dans le cadre de son temps. Il y a
dans tout l’ouvrage une sympathie pour le sujet traité, une affinité de pensée, une ressemblance dans la facilité féminine du style qui en feront une très bonne introduction à la lecture de Goblin Market et de The Prince’s Progress.
* L’auteur reconnait à Miss Shove une finesse toute féminine ? (sourire)²
