… est le jour de naissance (à Madrid) du grand poète et professeur de nationalité Espagnole, Pedro Salinas.
Pour l’évoquer, en ses qualités, convoquons l’hommage que lui fit soixante ans plus tard Jean-Louis Flecniakoska dans les Cahiers du Sud
Le poète espagnol Pedro Salinas est mort dans le courant du mois de décembre 1951 ; il avait cinquante neuf ans. L’événement est resté à peu près inaperçu en France ; un télégramme annonça la nouvelle à la grande presse qui se borna à la répéter laconiquement, tandis que des hebdomadaires, peu nombreux, ne renvoyaient que des échos légèrement amplifiés.
Pedro Salinas a disparu de notre univers avec cette même discrétion qui a marqué sa vie tout entière et qui demeure l’un des aspects les plus significatifs de son œuvre.
(…)
Pedro Salinas alliait à une culture étendue et solide les dons d’artiste les plus remarquables et les qualités de cœur que se sont plu à souligner tous ceux qui ont eu la borne fortune de l’approcher.
Ce n’est pas sans émotion que nous nous rappelons la haute silhouette du poète dont les yeux clairs exprimaient à la fois tant de sérénité, de bonté, lorsque nous allions lui demander renseignements et conseils, en 1935-36, alors qu’il présidait, avec une délicate, mais effective autorité, aux destinées du Centro de Estudios Historiens de Madrid où s’élaborait, dans l’enthousiasme, la formation d’une fervente jeunesse qui aurait pu être l’élite de la nouvelle République si celle-ci n’avait été torpillée avant d’avoir atteint sa maturité. (Note : Allusion à la guerre d’Espagne, qui contraignit Pedro Salinas à l’exil en Amérique du Nord, lieu de son décès (Boston))
(…)
Pedro Salinas aimait la France, — sans redondance et sans trémolo dans la voix — avec une sincérité qui touchait parce que tout éclat en était banni et peut-être aussi parce qu’il n’hésitait pas à en jauger les grandeurs et les petitesses. (Note :Les Espagnols étudient davantage la littérature française qu’en France … toute autre littérature)
Exquis connaisseur des arcanes de notre langue et de notre pensée, c’est lui qui fit apprécier, en Espagne, la prose de Marcel Proust, grâce à d’excellentes traductions de « l’Ombre des jeunes filles en fleurs » et de « Du côté de chez Swann » dans lesquelles il a su sauvegarder l’esprit de fine analyse, la richesse le l’expression et la subtilité verbale, malgré toute la difficulté que peut présenter la psychologie proustienne en langage castillan.
(…)
Pedro Salinas restera avant tout l’un des plus grands poètes de l’Espagne contemporaine au côté d’Antonio Machado, Juan Ramôn Jimenez, Federico Garda Lorca, Jorge Guillén, José Bergamin et Rafael Albert!.
(…)
…A travers ces diverses œuvres poétiques nous pouvons découvrir la courbe de l’évolution salinienne qui va de la quiétude d’une analyse subtile et sereine des moindres détails de la vie du cœur et des sens à l’angoisse qui s’empare du poète au lendemain des guerres sanglantes qui ont frappé l’Espagne d’abord et le monde ensuite.
L’auteur s’attache à chanter, comme son aîné Antonio Machado (…) les démarches intimes du cœur humain. Il abandonne les grands thèmes de la génération de « 98 », laquelle s’acharnait à tout rattacher au problème de l’Espagne « essentielle» (…) en même temps qu’il s’éloigne du faux cosmopolitisme, du «Modernisme » aux fanfares éclatantes, aux pavois chatoyants, aux amours à la fois faunesses et versaillesques.
(…)
Pedro Salinas demeure le chantre des mille petits détails qui sont le lot d’une intimité dénuée de toute prétention démesurée à la connaissance du monde et des hommes.
(…)
Tout en restant la poésie du détail, et même du détail apparemment insignifiant, l’œuvre de Pedro Satinas n’est pas une mièvre peinture des objets ou des événements mineurs de la vie quotidienne, non plus qu’une description réaliste d’un inonde familier. Chacun d’entre eux est élu pour les résonances psychiques qu’il fait naître et qui, en cercles concentriques, autour du thème initial, se multiplient et s’amplifient pour se perdre dans un doux susurrement qui laisse une impression de suprême délicatesse malgré son amplitude et son inéluctable néantisation.
(…)
Une feuille morte emportée par le vent d’automne s’envole-t elle sers l’autre hémisphère ; elle n’arrêtera sa course folle qu’en un pays où règne ce que l’homme appelle le printemps pour lui rappeler que cette délicieuse saison n’est qu’un état transitoire comme sa propre vie dont l’image charnelle, peu à peu, s’estompe ainsi que le chante le poème Morts, dans lequel on voit disparaître tour a tour le souvenir du timbre de la voix, du son du pas sur le pavé, du sourire, du regard, de la couleur du vêtement et même de cette chair palpitante dont bientôt il ne reste plus que le nom avec ses sept lettres. Hélas, constate le poète …
dans cet extrait de poème …
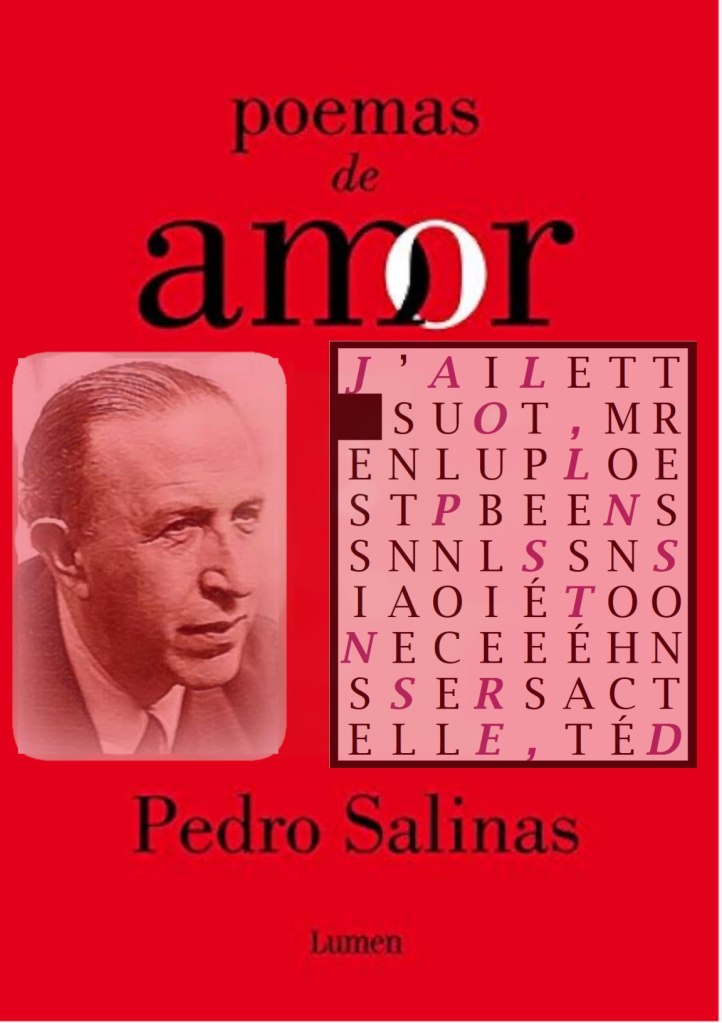
(Pour lire la grille plus facilement, cliquer ici)
(…)
Pedro Salinas n’a pas cessé, tout au long de son œuvre, de manifester le désir constant qui l’animait de se créer un monde où la mort n’aurait pas sa place, mais où le rêve s’épanouirait avec son éternelle aurore.
Le thème majeur de son œuvre, toujours plus présent au fil de ses écrits poétiques, est l’Amour.
Il y a quelque chose de mieux.
Il y a un quelque chose,
un pur amour qui plane
sur des airs surhumains
— galant de ce qui se cache —
et qui peut plus et plus haut
Ce quelque chose, c’est toute une existence qui se consacre
à la recherche du signe
que ni la fleur ni la pierre
ne veulent livrer
Pedro Salinas n’en est pas moins profondément ancré au présent, à un présent qui l’inquiète, pour ce qu’il en connaît et pour les chemins qu’il lui voit prendre.
L’œuvre d’art qui persiste représente cette victoire
« sur le tapis vert du temps, contre le temps banquier »,
dont nous parle Pedro Salinas dans sa préface à Tout plus clair. L’auteur de Zéro constate, hélas ! dans cette même préface, que
« dans les temples du progrès, on élabore d’une façon rationnelle la technique d’une régression définitive de l’être humain, le retour de l’être au non être ».
Le chantre délicat des intimités, délicieusement sceptiques, de l’éternel plastique et dont
« la poésie est toujours une œuvre de charité et de clarté »
ne reste pas insensible aux destructions qui menacent notre inonde meurtri par la guerre et qui semble se précipiter vers d’autres catastrophes plus terribles encore. Alors, sortant de la tour d’ivoire des contemplations intérieures, l’homme Européen par le cœur. Américain d’adoption et Espagnol de naissance — se révolte et, dans le
« vaste dessein de faire naître dans la conscience de quelque humain la sainte horreur d’une œuvre des hommes, dont il évite l’exacte désignation et le nom propre… comme le nom d’un péché qu’on n’ose pas nommer »
Il dénonce la monstruosité du plus affreux des moyens de destruction, ce nouveau zéro qui mûrit et qui aura sa dévotion ainsi que le prophétisait Antonio Machado.
Sans grandiloquence. Pedro Salinas, en termes douloureusement simples, dépeint d’abord cet acte insignifiant en soi, acte aveugle, impersonnel :
Bile tomba, aveugle. Il la lâcha,
ils la lâchèrent, à six mille
mètres de hauteur, à quatre heures.
Il remplit son obligation,
ce que les vingt cadrans
des instruments ordonnaient,
exactement, la lâcher
au moment exact :
Rien.
Au début,
il ne vit presque rien. Une
tache blanche, grandissant lentement,
blanche, plus blanche et maintenant candide (20).
Les nuages blancs, à première vue, ne peuvent pas faire de mal.
Serait-ce quelque immense troupeau d’agneaux, quelque chute extraordinaire
de flocons de neige ? Hélas ! derrière tant de blancheur immaculée,
sur la terre,
où le zéro tomba,
le grand désastre commençait
Le Texte qui suit est un poème d’amour. On y retrouve ce qui caractérise Pedro Salinas autant dans le thème que dans son expression poétique à savoir la puissance des images et leur échos sensuels en même temps qu’une gestion de la temporalité inventive et qui contribue grandement à « l’accueil » du lecteur au sein du poème.
«…La Voz a ti Debida »
(Titre emprunté à Garcilaso de la Vega)
Eglogue III
Tu vis toujours dans tes actes.
Du bout des doigts
tu fais vibrer le monde, tu lui arraches
aurores, triomphes, couleurs,
joies : c’est ta musique.
La vie, c’est ce que tu touches.
De tes yeux seulement
Sort la lumière qui guide
tes pas. Tu marches
parce que tu vois. C’est tout.
Et si un doute te fait
signe à dix mille kilomètres
tu laisses tout, tu te lances
sur des proues, sur des ailes,
tu es déjà là : de tes baisers,
de tes dents, tu le mets en pièces,
et le doute n’est plus.
Jamais, toi, tu ne peux douter.
Car, les mystères, tu les as
retournés. Et tes énigmes,
ce que jamais tu ne comprendras,
ce sont ces choses si claires :
le sable où tu t’étends,
le mouvement de ta montre
et le tendre corps rosé
que tu trouves dans ton miroir,
chaque matin, à ton réveil,
et qui est le tien. Les prodiges
qui sont déjà déchiffrés.
Et jamais tu ne t’es trompée,
sauf une fois, un soir,
où tu t’es éprise d’une ombre
— la seule qui t’ait plu —
On eût dit une ombre.
Et tu voulus l’étreindre
Et c’était moi.
*
* *
Peur. De toi. T’aimer
c’est le plus grand risque.
Multiples, toi et ta vie.
Je t’ai, celle d’aujourd’hui;
Je la connais, j’entre
par de faciles labyrinthes,
grâce à toi, à ta main.
Ils sont à moi, oui, maintenant.
Mais toi, tu es
ton propre au-delà,
comme la lumière et le monde :
jours, nuits, étés,
hivers se succédant.
Fatalement tu varies
sans laisser d’être toi,
dans ta variété même,
par la fidélité
constante du changement.
Dis-moi, pourrai-je vivre
sous ces autres climats,
ou futurs, ou lumières
que tu élabores, toi,
comme le fruit son jus,
pour ton lendemain ?
Ou bien ne serai-je que
ce qui naquit pour un seul
de tes jours {mon jour éternel)
pour un printemps
(en moi toujours fleuri)
sans pouvoir vivre encore
quand arriveront
se succédant en toi,
inévitablement,
les forces et les vents
nouveaux, les lumières tout autres
qui déjà, attendent le moment
d’être ta vie, en toi !
*
* *
Là-bas, au-delà du rire
on ne peut pas te reconnaitre.
Tu vas et viens, tu glisses
sur un monde de valses
gelées, sur la pente inclinée;
et en passant, les caprices,
les baisers, sans Vocation,
rapides, te soulèvent,
toi, la momentanée
captive de la facilité.
Qu’elle est gaie ! disent-ils.
Et c’est que tu veux, alors,
être cet autre
qui te ressemble tellement
à toi-même, que c’est ainsi
que j’ai peur de te perdre.
Je te suis. J’attends. Je sais
que lorsque tu ne seras plus regardée
par les tunnels ni les étoiles,
que lorsque le monde croira
savoir qui tu es
et qu’il dira : « Maintenant je sais »
tu déferas un nœud,
les bras en l’air,
sous tes cheveux,
tout en me regardant.
Sans bruit de cristal
par terre tombera,
léger masque
inutile, ton rire.
Et en te voyant dans l’amour
que toujours je te tends
comme un miroir ardent,
tu reconnaîtras
un visage sérieux, grave,
une inconnue
grande, pâle et triste
qui est mon amante. Et qui m’aime
au-delà du rire.
*
* *
Point n’ai besoin de temps
pour savoir ce que tu es :
se connaître c’est un éclair.
Qui pourrait te connaître, toi,
par ce que tu tais, ou par les mots
avec lesquels tu le tais ?
Celui qui te cherchera dans ta vie
ne pourra savoir de toi
que des allusions,
des prétextes où tu te caches.
Te poursuivre dans le passé,
dans ce que tu fis naguère,
additionner acte et sourire,
années et noms, ce serait
te perdre. Moi, non.
Je t’ai connue, dans l’orage,
Je t’ai connue, soudaine,
dans le déchirement brutal
des ténèbres et de la lumière,
là où se révèle le fond
qui échappe au jour et à la nuit.
Je te vis, tu m’as vue, et maintenant
dévêtue à jamais de l’équivoque,
de l’histoire, du passé,
toi, amazone de l’éclair,
palpitante de la récente
arrivée, sans que je t’ai attendue,
tu es à moi depuis fort longtemps,
je te connais il y a tant de jours,
que dans ton amour je ferme les yeux,
et que je marche sans erreur,
à tâtons, sans rien demander
à cette lumière lente et sure
dans laquelle on connaît lettres
et formes, on fait des comptes,
et l’on croit voir
celle que tu es, toi, mon invisible.
Horizontale, oui, je t’aime.
Le ciel, regarde-le
face à face. Ne cherche plus
à feindre un équilibre
qui nous fait pleurer toi et moi.
Rends-toi
à la grande vérité finale,
à ce que tu dois être avec moi,
étendue, parallèle,
dans la mort ou le baiser.
La nuit est horizontale
sur la mer, une grande masse tremblante
couchée sur la terre,
vaincue sur la grève.
Être debout, mensonge,
rien que courir ou s’étendre.
Et, ce que nous voulons, toi et moi,
comme le jour — bien fatigué
d’être debout avec sa lumière —
c’est que nous arrive en pleine vie,
dans un tremblement de mort,
à la pointe extrême du baiser,
le moment d’être rendus,
par l’amour le plus aérien
au poids d’un être de terre,
matière, chair vivante.
Dans la nuit et l’après-nuit,
dans l’amour et après l’amour,
enfin changés, toi et moi,
en horizons définitifs
de nous-mêmes.
Ce que tu es
me distrait de ce que tu dis.
Tu lances des mots rapides,
pavoises de rires,
m’invitant
à aller où ils me conduiront.
Je ne t’écoute pas, je ne les suis pas,
je reste, regardant
les lèvres où ils sont nés.
Soudain tu regardes au loin,
Là-bas tu fixes ton regard
je ne sais sur quoi, et voilà lancée
pour le chercher ton âme
aiguisée de flèche.
Moi je ne suis pas ton regard
je te vois regarder.
Et si tu désires quelque chose
je ne pense pas à ce que tu veux,
et je ne l’envie pas : cela n’est rien.
Tu le veux aujourd’hui, tu le désires,
tu l’oublieras demain
pour un autre caprice
Non. Je t’attends au-delà
des limites et des frontières
dans ce qui ne peut passer
…
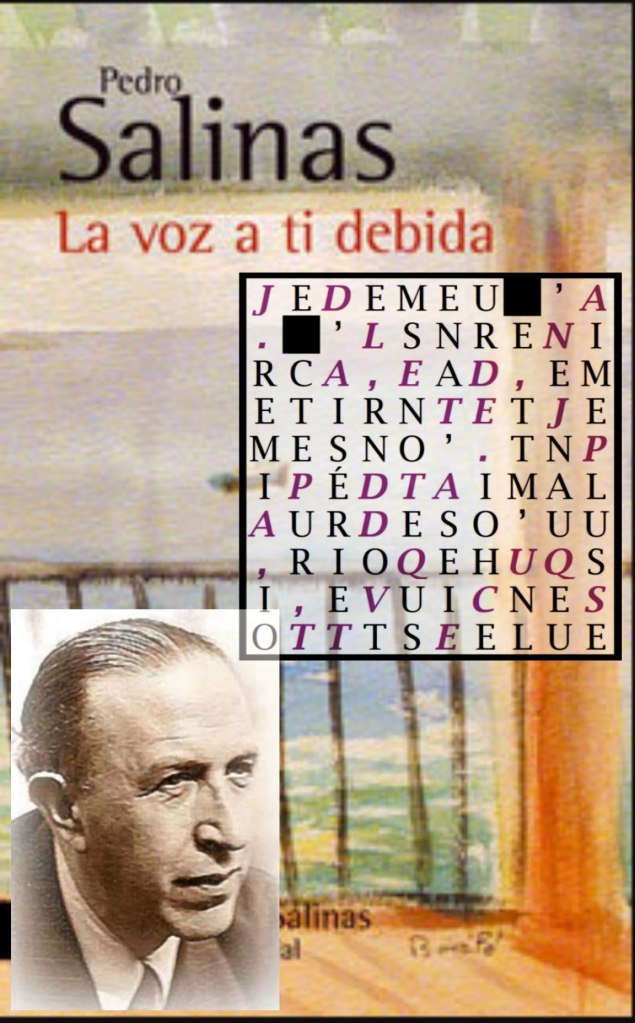
Pedro Salinas
1934
(traduit par Suzanne Brau)
