… Maurice Magre disparait de la scène littéraire où il a eu une grande présence, en tant que poète, dramaturge, librettiste, essayiste …
scène qui n’a pas accaparé toute son activité puisqu’il a également été très prolifique et respecté dans le monde de l’ésotérisme.
Il a notamment (sourire)² préfacé l’introduction à l’astrologie (renouvelée) de Don Néroman* « Planètes et Destins«
___
* (Auteur de « La leçon de Platon« ) qui qualifie Maurice Magre de « poète de l’occultisme » (dans « La pleine de vérité« )
On peut suivre Maurice Magre à travers la presse du début du XXème siècle qui l’a suivi de près.
Dans « la plume « du 15 juillet 1898, Maurice Magre a alors 22 ans
La CHANSON DES hommes, par Maurice Magre.
Sous ce titre superbe, la Chanson des Hommes, un jeune poète de vingt ans» M. Maurice Magre vient de nous donner un recueil de poèmes à la fois lyriques et simples, ardents et généreux. Il y a dit les hommes de tous les jours, occupés aux tâches familières, ceux des Faubourgs, ceux de la Glèbe et ceux de la Mer. Il les a regardés avec une sorte de tendresse mêlée d’une pitié vague, avec ce genre d’émotion triste et résignée qu’exprima dans des toiles mémorables le peintre François Millet.
Ainsi donc, si vous êtes amateurs de curiosités verbales, de rythmiques fantaisistes ou d’étranges vocabulaires, il est bien inutile que vous ouvriez ce livre. Vous pouvez frapper a d’autres portes. Car tout est simple, ici. Les breuvages y sont frais. Les métaphores y sont fraîches, et les objets les plus simples du monde en composent l’ornement.
Par sa façon et par son allure, le vers de Maurice Magre nous rappelle Musset — parfois même Pierre Dupont par son, inspiration — et son lyrisme plein de flammes et d’aisance nous a fait, en maints endroits, penser a Jean Richepin. Sa muse vêtue d’un fruste lin, harmonieusement drapée. n’a pas redouté de s’égarer dans les humbles logis et dans les quartiers pauvres; elle s’avance candidement vers les pâles créatures souffrantes; elle leur sourit; elle vient les guérir du « péché de pleurer.
Ce qui me plaît, ce qui m’enchante, dans la poésie de Maurice Magre, c’est qu’elle a une raison humaine, je dirai presque une raison sociale. Cette poésie présente d’étroits rapports avec notre époque, avec la société où nous vivons. Elle jaillit à son heure, en pleine crise de gestation révolutionnaire, dans le moment où le parti socialiste français s’organise d’une façon formidable. Elle clame l’infortune prolétarienne sur un ton souvent sentimental, mais avec des accents d’une véhémence vraiment forte.
Non pas que Maurice Magre prêche la haine, la révolte brutale et stérile : il est trop naturiste pour s’oublier jusqu’à blasphémer, il a trop le sens de la vie. Et puis, comme toutes les âmes généreuses, c’est la foi dans l’avenir qui le soutient; il croit à la venue des futures races, il rêve de prochaines ères,
pacifiques et bienheureuses. Il a dit le rêve de pain, de vin, de soleil, de ceux qui ont faim et de ceux qui ont froid. Il raconte leur malheur, et leur joie aussi, la joie de leur vie végétative, dans les cités et les campagnes. Il a compris I’homme qui travaille, et qui aurait droit a un peu de bonheur et a un peu de poésie lui aussi.
Voilà pourquoi je distingue en M. Maurice Magre le grand poète populaire de notre génération.
Ici le rédacteur de l’article, Maurice Leblond, plaide contre « les réactionnaires » pour l’éducation du peuple, mais d’une manière qui serait jugée précisément réactionnaire par certains aspects, comme par exemple la volonté d’émergence d’une nouvelle race ayant des caractéristiques très précises.
Depuis longtemps, ce rôle de poète populaire, personne n‘avait osé le prendre. On dédaignait, parmi les gens de talent, de donner aux foules la nourriture spirituelle. On confiait ce soin a des personnalités médiocres comme MM. Déroulède et Coppée, écrivains réactionnaires qui exaltaient à leur aise leur sentiment militarisée et catholique.
Notre génération a enfin compris le danger qu’il y avait à laisser les masses incultes. C’est pourtant la mission de la poésie de faire vibrer nos démocraties, de les rendre plus harmonieuses, d’éclairer leurs conceptions encore obscures, à l’aide de belles proses et de radieux poèmes.
Ah ne laissons pas le peuple en proie aux vulgaires déclamations des démagogues, mais marchons à sa rencontre, en chantant, avec des gerbes plein les bras.
Ce sont ses muscles forts et ses torses puissants qui portent orgueilleusement les races de demain, et les larges seins roses de cette paysanne, courbée aux durs travaux, peut être sont-ils gonfles du sang des doux martyrs et vie
tristes apôtres!
Marchons vers eux, donnons-leur la joie du verbe, des rythmes des chansons. Dans les champs en friche de la pensée, ce sont les poètes qui préparent le
terrain pour la bonne semailles. Leurs bucoliques et leurs cantiques suffisent a nourrir l’âme enfantine des grandes tribus. Le christianisme n’a jamais eu recours aux théologiens pour conquérir les cerveaux populaires. La poésie contenue dans ses évangiles et dans ses liturgies suffisait. Or aujourd’hui que périssent et s’écroulent les religions spiritualistes, c’est à nous de ressusciter de nouvelles pompes poétiques, de célébrer, par de nouvelles paraboles et de nouvelles métaphores, la religion future : le culte de la terre et de la vie. Il faudra que nous en écrivions les divines prières. Et ce n’est peut-être qu’au son glorieux des lyres que la croyance générale dans le panthéiste et le socialisme s’établira définitivement au fond des consciences françaises.
Ici le critique donne une mission au jeune Maurice Magre. Celui-ci l’a-t-il entendue ? Avait-t-il déjà des projets de cette nature ? Ceux-ci ont-ils été confortés, influencé par cet éloge dithyrambique ?
De fait, Maurice Magre participera au renouveau d’une pensée païenne autour d’un ésotérisme retrouvé, rénové à la lumière du progrès des sciences qui produira de nouvelles lectures des écrits anciens, dont les philosophes grecs et les textes de mystiques arabes ou juifs.
A l’appui de ses espérances, Maurice Leblond, donne un texte issu de l’œuvre critiquée, qui lui semble être à l’orée de celles-ci. Il le présent ici.
M. Maurice Magre a-t-il réussi, dans la Chanson des Hommes, à écrire ces prières dont je parle ? Pas encore, je l’avance en toute justice. Mais tout laisse présager qu’il pourrait bien le faire un jour.
Quelques-uns de ses grands morceaux lyriques comme la Pitié, le Pauvre, le Retour des Bergers, les Soldats, les Prêtres ou la Grande Plainte — qui semble inspirée de certaines prosopopées socialistes de Zola — toutes ces pièces sont destinées au plus grand retentissement.
Je me bornerai à citer ici L’Hymme à la vie qui est parmi les plus purs et les plus radieux de ce livre :
Salut, Père des bois, des eaux et des charrues,
Vers qui va la chanson des justes et des purs.
Les venus sous les toits de chaume sont venues
Nous apporter les rameaux verts, les outils durs.
Nous voulons vivre simplement parmi les choses :
Nous serons au flot clair des sources fiancés,
Et nous respirerons les vents qui font pleurer
Le cœur mystérieux et tragique des roses.
Nous ne demandons plus, ô Seigneur, le secret
Des forces inconnues menant les pluies étranges
Et quel est le passant rêveur qui vient semer
Le soir, des astres d’or dans les pailles des granges
Qu’importe le retour alterné des saisons
Et le passage des oiseaux dans les contrées
Pourvu qu’un peu de feu brille dans les maisons
Et que le grillon rie dans les herbes coupées,
Qu’importe la naissance obscure des ruisseaux
Et comment sourd la vie dans les forêts sacrées,
Les chèvres danseront aux chansons des pipeaux
Quand les pâtres enfants iront vers les dallées.
Il nous suffit que le vrai Dieu, le Dieu Soleil
Répande sur la terre rude en tous les âges
La lumière des faux parmi les champs vermeils.
Dicte aux hommes futurs la loi des labourages,
Sous les vignes tordues accroche des raisins.
Mette des cris d’agneaux au fond des bergeries,
Fasse monter les blés et tourner les moulins,
Et luire les pains clairs dans les boulangeries…
(Note : Lorsque Maurice Magre présent le Soleil comme le « vrai Dieu », il est en accord (sans le savoir ?) avec le moine calabrais Tommaso Campanella qui a écrit, comme une réponse à « La cité de Dieu » de saint Augustin, son utopie « La cité du Soleil« )
Une autre œuvre de Maurice Magre : « La monté aux Enfers » et donc une autre critique, dans « Le carnet de la semaine » va nous faire découvrir, l’évolution du poète, dans ses thèmes et dans ses convictions.
(parenthèse)
Critique de la féministe Henriette Sauret
profitons en pour faire un détour vers son poème « Elles » du le recueil « Les Forces détournées »
Et voilà. On les fit en …

Misère ! on vous jugule, on vous pipe, on vous ment !
(Pour lire la grille plus facilement …(c’est bien aussi la lecture lente) … cliquer ici)
(fin de la parenthèse)
Après avoir décrit le poète, notamment comme un homme qui s’entoure d’ami « plus pour l’intérêt qu’il trouve en eux que pour se faire une escorte flatteuse » Henriette Sauret évoque la brillante carrière de Maurice Magre, qui tient au fil des ans la place qu’il s’est forgée (publications régulières suivies de succès).
Elle indique qu’il a participé à l’effort de guerre (la grande) en organisant » avec un zèle averti des matinées pour les blessés, dans les hôpitaux. » des séances d’un caractère inédit puisque « sous l’égide de Maurice Magre,
compétent en jolies femmes et en vraie poésie, de fines actrices récitèrent aux soldats, du Musset, du Verlaine, du Sully-Prud’homme, voire du Maurice Magre.«
Puis elle en vient au fait, à savoir une publication qui témoigne de la nouvelle direction prise par Maurice Magre en rapport avec les notions de bien et de mal. L’ésotérisme pointe à l’horizon.
Ce livre parait et ce livre tombe comme une pierre étincelante dans la mare aux médiocrités présentes.
« La Montée aux Enfers » c’est une somptueuse diversion, une parenthèse reposante, une heure d’oasis
pour les pauvres pensées cernée et jugulées par la littérature d’Etat. Un cri d’admiration presque unanime
y a répondu.
Cependant, M. A. Billy qui manie la férule dans « l’Œuvre » n’apprécie pas ce livre et reproche à Maurice Magre l’imitation de Baudelaire.
Il y a pire modèle. Mais Maurice Magre n’a pas imité Baudelaire. Tout en ressemblant au grand poète par certains côtés, il en diffère profondément.
Il y a chez Maurice Magre une joie de l’horreur, une audace païenne, une agressive affirmation de ses
goûts singuliers que n’avait point le plaintif, le houleux, l’hypochondre Baudelaire.
Maurice Magre est le maître du démon qu’il a librement choisi.
Maurice Magre nie le mal et le bien. Mieux, il est convaincu que ce qu’on nomme mal, permet au contraire l’exaltation suprême de nos pouvoirs, et que, dans ce mal, doivent plonger les racines de toute recherche, de tout effort, aspirant à l’absolu de la connaissance terrestre.
Et par delà sa témérité, sa vigueur, sa richesse et couleur, Magre a fait preuve — à son insu peut-être,
d’une habileté supérieure : il n’a pas dit un mot de la guerre. Il a situé son œuvre hors des temps, hors des pays. Ainsi, l’heureux homme a évité les démêlés avec certains ciseaux. Car, à cette heure, dès l’instant que vous « n’en » parlez pas la censure vous autorise à peindre les vices les plus osés, les lubricités les plus
crues, les orgies les plus borgiesques et les plus frénétiques débordement.
L’évolution de l’écriture de Maurice Magre sera confirmée par Jean Ernest-Charles qui nous en dit quelques mots
Mais ne sollicitons plus de leçons de vivre du romancier Maurice Magre. Cela pourrait nous entraîner trop loin comme on dit. Maurice Magre, du moins, s’affirme ici comme un romancier quasi hallucinant des déséquilibrés de tous les mysticisme.
Peu de romanciers aujourd’hui plongent dans cette atmosphère trouble où se meuvent ces demi-déments effrénés. Maurice Magre leur communique une animation extrême. Ils ont l’air tous
d’être emportés dans une danse tragique et saugrenue ; et il s’en faut de très peu que, avec cette puissance de persuasion des forces, ils n’emportent les spectateurs qui voudraient bien se
contenter d’être prodigieusement intéressés, comme ils le sont.
Et, en fin de compte, l’incomparable réussite de Maurice Magre nous amène à une pitié stupéfiée, ahurie, effarée, oh, en outre, amusée.
Fasciné par le mal, Maurice Magre se retrouve très loin du poème sur lequel je souhaite le quitter
ENVOI
Je suis pareil à cet enfant
Qui, laissé seul, dans sa détresse
Fit une lettre et, comme adresse,
Mit simplement : Paris, maman…
De ceux qui m’aimeraient, peut-être,
Moi aussi je suis seul très loin ;
Au …
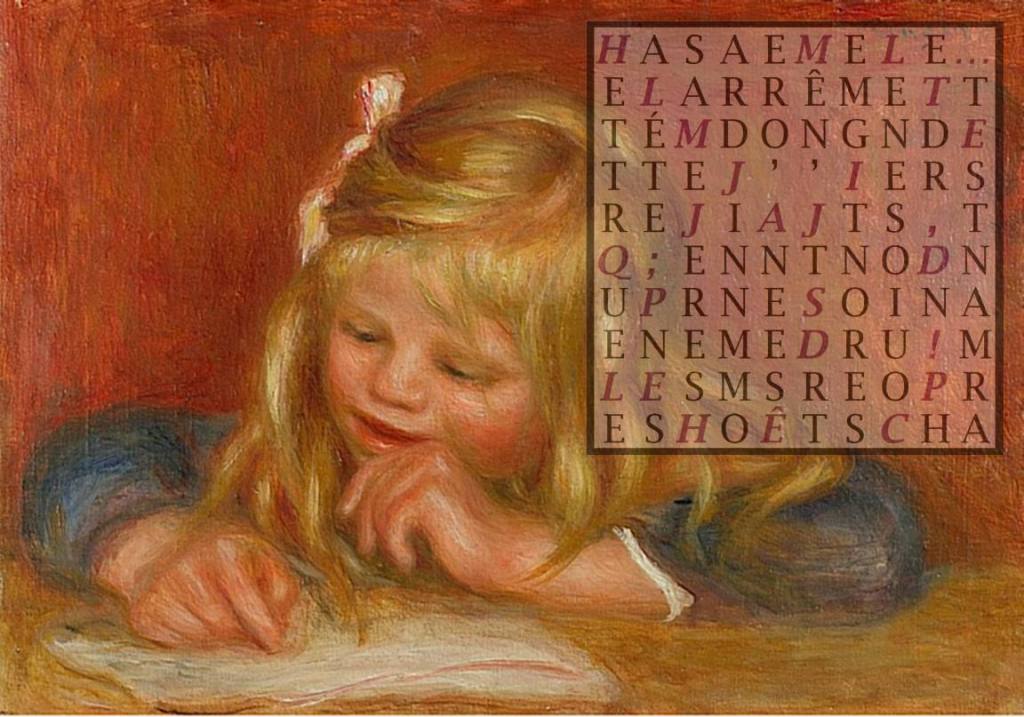
…nom,
J’ai fait ces petites chansons…
Puisse une femme les comprendre !
J’ai transcrit là sincèrement
Mon cœur ingrat et peu fidèle…
Maman, Paris… écrit l’enfant…
Mais la lettre arrivera- t- elle ?
Les Lèvres et le Secret, 1906
