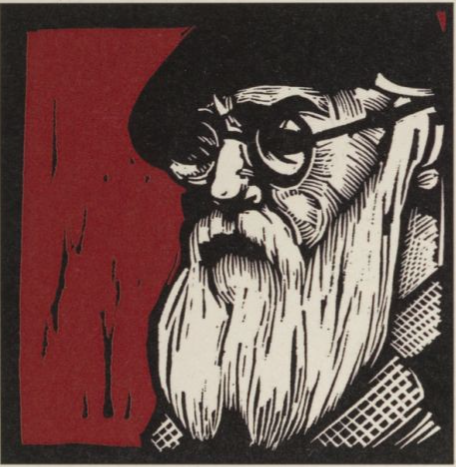… nait celui qui deviendra un poète loin des courants de son époque, mais qui donnera vie dans ses poèmes « aux choses » qui l’environnent : Francis Jammes
André Beaunier dans Les Annales politiques et littéraires de 1913 évoque cette singularité, l’attachement au réel le plus … réel, dans une France où le surréalisme va surgir.
Avec en tête de son article deux citations de Francis Jammes (à laquelle il donne, ce qui me semble être un artifice déplacé concernant F.J., une forme de poème)
« C’est avec légèreté que, la
plupart du temps, nous touchons
aux choses. Mais elles sont pareilles
à nous, souffrantes ou
heureuses… »
« J’ai connu des choses en
souffrance. J’en sais qui sont
mortes… »
(FRANCIS JAMMES. Des Choses.)
« Paroles » extraites du texte original qui est dans sa forme publiée, de la prose
« C’est avec légèreté que, la plupart du temps, nous touchons aux choses. Mais elles sont pareilles à nous, souffrantes ou heureuses. Et, lorsque je remarque un épi malade parmi des épis sains, et que j’ai vu la tache livide qui est sur ses grains, j’ai très nettement l’intuition de la douleur de cette chose.
En moi-même, je ressens la souffrance de ces cellules végétales, j’éprouve la difficulté qu’elles ont à s’accroître sans s’opprimer l’une l’autre à l’endroit contaminé. Le désir me vient alors de déchirer mon mouchoir et de bander cet épi. Mais je songe qu’il n’est point de remède permis pour un seul épi de blé, et que ce serait humainement un acte de folie que de tenter cette cure, encore que l’on n’observe rien à ce que je prenne soin d’un oiseau ou d’une cigale. Cependant, la souffrance de ces grains m’est certaine puisque je la ressens. »
« J’ai connu des choses en souffrance. J’en sais qui sont mortes. Les tristes hardes de nos disparus s’usent vite. Elles s’imprègnent souvent des maladies mêmes de ceux qui les vêtirent. Elles ont leur sympathie. »
(FRANCIS JAMMES. Des Choses.)
On voit qu’ici, les choses ne sont pas restreintes à la matière inanimée bien que celle-ci soit concernée*. Le mot a vu à notre époque une restriction conséquente de son application/sens.
Francis Jammes a senti dans les « choses » une âme fraternelle, une âme analogue à la sienne. Il les comprend. Elles ne sont pas pour lui de quelconques objets que l’on manie, que l’on applique à des usages divers. Il les sait animées de passions, — à vrai dire, peu exubérantes, mais plus intenses peut-être qu’on ne les suppose à les voir si calmes et, comme il se les figure, si résignées. Et il s’étonne de leur simple douceur, et il admire leur esprit de sereine acceptation. Les pierres l’émeuvent et il les plaint; et n’est-ce pas une vieille croyance irréfléchie, presque un instinct qui survit en lui? car la locution populaire a conservé la foi primitive aux pierres « malheureuses ». A tous les éléments du monde, les plus rudes et ceux qui paraissent les plus stupides à qui passe trop vite et distraitement par le chemin, Francis Jammes attribue une sorte d’obscure pensée, une aptitude à des douleurs et à des joies secrètes que l’on devine mieux qu’on ne les voit.
L’auteur de l’article entend bien distinguer cette affinité avec ce qui habite la « nature » de celle qu’ont pu avoir les romantiques. Francis Jammes n’est pas de ceux qui « aperçoivent autour d’eux des images d’eux-mêmes«
Les romantiques sacrifièrent à cette erreur; ils attribuèrent aux paysages des tristesses ou des allégresses semblables à celles qui, momentanément, étaient les leurs, et ils voulurent que les lacs — pour qui leur prédilection fut grande — prissent part à leur propre tourment.
Ils se plaisaient à enregistrer que les saules pleuraient comme eux; et si, parfois, il y avait du soleil printanier sur les collines en fleurs, cependant qu’ils avaient une raison plausible de mélancolie, ou bien ils niaient, avec cette intrépidité qui les caractérise, que le soleil du printemps fût joyeux, ou bien ils s’indignaient véhémentement contre un tel manque de tact de la Nature méchante et qui les taquinait.
Francis Jammes, lui, a trop bien compris l’âme intime des choses pour la traiter avec cette désinvolture. Il a le sentiment de leur dignité, il respecte leur personne, il ne veut pas les rabrouer ni les violenter. Il se fait humble devant elles, et il tâche de les comprendre sans les dénaturer par l’indiscrète intrusion de lui-même en elles…
C’est pourquoi ses descriptions ont ce double caractère, d’être à la fois toutes pleines de lui et, cependant, impersonnelles.
Pour donner matière à ce propos d’André Beaunier, je donne ici la fin du texte de Francis Jammes « Des Choses »
Est-il permis de dire que jamais les choses ne nous donnèrent des manifestations de leur sympathie ? L’outil qui ne sert plus la main de l’ouvrier se rouille aussi bien que l’homme qui délaisse l’outil.
J’ai connu un vieux forgeron. Il était gai au temps de sa force, et l’azur entrait dans sa forge noire par les rayonnants midis. L’enclume joyeuse répondait au marteau. Et le marteau était le cœur de cette enclume, mû par le cœur de l’artisan. Et, quand tombait la nuit, la forge s’éclairait de sa seule lueur, du regard de ses yeux de braise qui flambaient sous le soufflet de cuir. Un amour divin unissait l’âme de cet homme à l’âme de ces choses. Et quand, aux jours dominicaux, le forgeron se recueillait, la forge, nettoyée la veille, priait aussi dans le silence.
Ce forgeron était mon ami. Souvent, du seuil noir, je l’interrogeais et c’était la forge tout entière qui me répondait. Les étincelles riaient dans le charbon et des syllabes de métal formaient une langue mystérieuse et profonde et qui m’émouvait ainsi que des paroles de devoir. Et j’éprouvais là à peu près les mêmes choses que chez l’obscur savetier.
Un jour, le forgeron tomba malade. Son haleine devint courte, et je sentais bien que lorsqu’il tirait la chaîne du soufflet, jadis puissant, celui-ci haletait aussi, pris peu à peu du mal du maître. Le cœur de l’homme eut des sursauts, et j’entendis bien que, lorsque l’ouvrier brandissait le marteau sur l’enclume, l’outil battait le fer irrégulièrement Et à mesure que le regard de l’homme avait moins de lumière, la flamme du foyer éclairait moins. Le soir, elle vacillait davantage et, sur les murs et le plafond, il y avait de longs évanouissements de lueur.
Un jour, l’homme sentit en travaillant l’extrémité de ses membres se glacer. Le soir, il mourut. J’entrai dans la forge. Elle était froide comme un corps privé de vie. Une petite braise luisait seule sous la cheminée, humble veilleuse que je retrouvai à côté du lit mortuaire auprès duquel priaient deux femmes.
Trois mois après, je pénétrai dans l’atelier abandonné pour assister à l’évaluation de son petit mobilier. Tout y était humide et noir comme dans un caveau. Le cuir du soufflet s’était troué en se pourrissant et, lorsqu’on voulut faire jouer sa chaîne, elle se détacha du bois. Et les …

… maître. »
Alors, je fus ému, car j’entendis le sens mystérieux de ces paroles.
(Pour lire la grille plus facilement, cliquer ici)
Terminons cette évocation de Francis James, par un de ses premiers poèmes, qui pourrait être un écho à Ronsard
Tu viendras
Tu viendras lorsque les bruyères au soleil
près des routes qui se fendent ont des abeilles.
Tu viendras en riant avec ta bouche rouge
comme les fleurs des grenadiers et des farouches.
Tu lui diras que tu l’aimes depuis longtemps,
mais en lui refusant ton baiser en riant.
Mais lorsque tu voudras le lui donner, alors
tremblante et suante, tu verras qu’il est mort.
La rencontre de Francis James avec Paul Claudel modifia considérablement sa vision de la réalité et par conséquence sa poésie.
Mais cela, comme dirait Kipling … c’est une autre histoire.