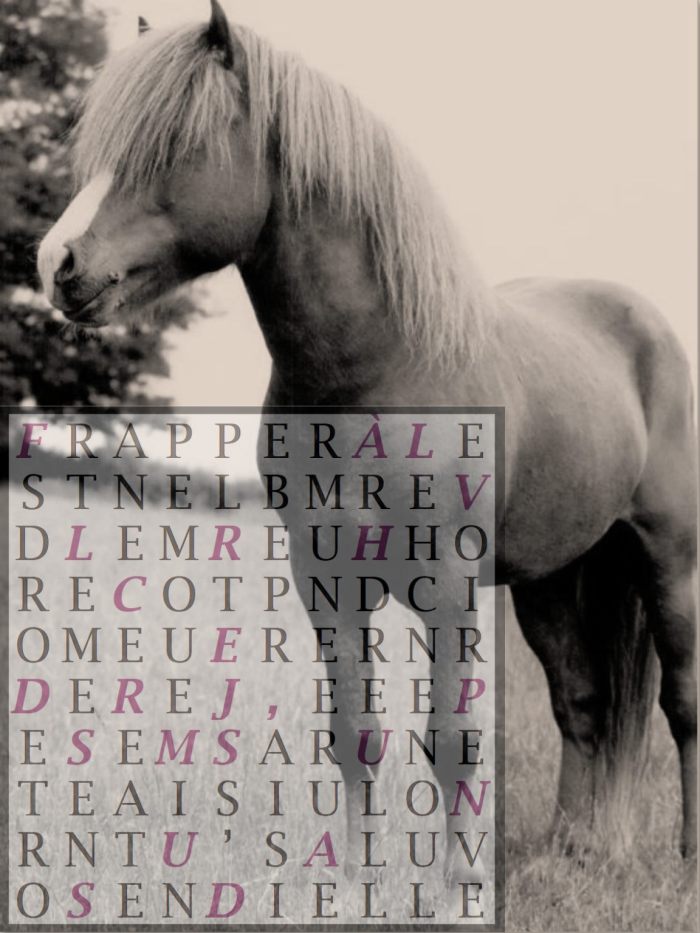… il sera question ici de chevaux.
Et plus particulièrement des chevaux islandais du XIXème siècle.
A cette date est en effet paru dans le périodique « La Science pittoresque » un article qui évoque au lecteur ce cheval si particulier et dont l’espèce n’a pas varié depuis le Xème siècle.
Le rédacteur de l’article (non identifié) donne à connaître, avec beaucoup d’enthousiasme, toutes les qualités de ce petit cheval qu’il a eu l’occasion de monter
(Extraits)
En Islande, tous les voyages se font avec des chevaux d’une race particulière, des chevaux petits comme ceux de la Corse, forts et adroits comme ceux des Pyrénées, agiles comme les poneys de l’Irlande.
La nature les a donnés comme une compensation à cette pauvre terre d’Islande car ils sont doués d’une patience, d’une douceur, d’une sobriété admirables.
Le voyageur peut se fier à eux quand il gravit les montagnes, quand il traverse les marais. L’instinct les guide à travers les sinuosités les plus tortueuses et le sol le plus fangeux. Là où ils posent le pied le terrain est sûr; s’ils tâtonnent, c’est qu’ils cherchent leur route; s’ils résistent à la bride, c’est que le cavalier se trompe.
Quand ils ont voyagé tout le jour, l’Islandais les lâche le soir au milieu des champs; ils s’en vont ronger la mousse des rochers, et reparaissent le lendemain frais et dispos comme la veille.
Quand vient l’hiver, le sort de ces pauvres bêtes est bien triste. Le paysan, qui n’a jamais assez de foin pour nourrir tout son troupeau, garde seulement, un ou deux chevaux et chasse les autres dans la campagne.
C’est grande pitié que de les voir alors errer au hasard pour chercher un peu de nourriture et un abri. Ils grattent le sol avec leurs pieds pour trouver sous la neige quelques touffes de gazon; ils s’en vont au bord de la mer mâcher les racines flottantes, les fucus; quelquefois on les a vus ronger les planches humides des bateaux.
Lorsque le printemps arrive, beaucoup d’entre eux ont péri, ceux qui survivent aux rigueurs de l’hiver, à la disette, sont tellement maigres et exténués qu’à peine peuvent-ils se soutenir. Mais dès que la neige est fondue et que l’herbe pousse, ils reprennent leur vigueur.
Le jour, si le vent du Nord souffle avec violence, ils se serrent les uns contre les autres, le dos tourné au vent, la tète au centre du groupe, et forment ainsi une phalange arrondie et compacte sur laquelle l’orage a peu de prise. Outre le froid et la famine, ils ont à redouter encore les inondations. Il y a en face de Reykjavik une petite ile fort basse où un paysan avait conduit, au commencement de l’hiver dernier, un troupeau de moutons. Le printemps venu, il alla le chercher et ne trouva plus rien: les vagues de la mer avaient tout enlevé.
Ici, à la fin de ce passage, on mesure l’évolution, depuis cette époque, chez l’humain en général de la perception de l’animal, de sa souffrance et l’incongruité qu’il y avait à cette époque à avoir vis à vis de lui « comme une sorte de remords »
Celui qui étudie la nature sous ses divers aspects doit une belle page à ces pauvres et chétifs animaux qui, sur une terre ingrate comme celle d’Islande, partagent toutes les privations, toute la misère de l’homme.
Pour moi, dussé-je faire rire ceux qui n’ont jamais compati aux souffrances des animaux, j’avoue que, dans mes excursions en Islande, j’ai souvent pressé entre mes mains, avec attendrissement, la tête de mon cheval qui me portait si patiemment à travers les sentiers rocailleux, qui n’abusait ni de mon ignorance des chemins, ni de ma maladresse de cavalier; et lorsqu’il m’ arrivait de le …
(Pour lire la grille plus facilement, cliquer ici)
… comme lorsqu’on commet une injustice.