… est né dans le Mississipi un poète qui sera naturalisé anglais et…
qui s’est vu décerner le prix Nobel de littérature six ans après la publication de son recueil Quatre Quatuors. Oeuvre qui vaudra un prix (prix « Denyse-Clairouin ») à sont traducteur Pierre Leyris.
Dans le journal Combat (tendance à gauche) de janvier 1948, Maurice Nadeau, donne un long article consacré à T.S. Elliot. Il y évoque notamment les raisons pour lesquelles T.S. Eliot ne serait et ne pourrait être un écrivain populaire.
« (il) ne sera jamais un poète populaire.
Non que le grand public soit tout a fait imperméable à une parole qui serait à la fois forgée par Valéry, Claudel et Michaux, non même que cette poésie soit, comme celle de Mallarmé par exemple, difficilement accessible.
Eliot parle au contraire simplement et sans prétention, mais ce qu’il dit a moins d’importance que ce qu’il cache et, qui veut comprendre son œuvre, en percer les intentions, en saisir les allusions et en compléter les ellipses, doit posséder une somme de connaissances extraordinaire.
Nous n’avons pas en lui une âme qui se met à nu, le chantre d’un milieu, d’une époque ou d’une civilisation, bien qu’il puisse être considéré sous chacun de ces angles, mais quelqu’un qui assume toute l’histoire de l’humanité, des origines à nos jours, qui la suppose connue au même degré par le lecteur et constamment présente à son esprit.
Il a voulu s’insérer dans une tradition appréhensible par la seule poésie et qui comprend l’Orient, la Grèce, Rome, Jérusalem, l’Occident et, pans cet Occident, aussi bien la lignée anglo-saxonne que la latine. Il a déclaré que ses premiers poèmes procédaient à la fois de Jules Laforgue et du théâtre élisabéthain, mais on retrouve chez lui des parentés avec Whitman, Edgar Poe, Shakespeare, Milton, Dante, Nerval, Mallarmé, Proust, tandis que son apport personnel a été comparé à celui des futuristes russes ou de Dada.
Terme de la poésie de son époque, sa création est jugée si neuve qu’elle influence la jeune poésie anglaise depuis vingt ans. en présence de cette œuvre, mince par le volume mais de dure consistance, violente et contrastée, allusive et elliptique, l’intuition, le cœur, l’intelligence, le savoir sont mobilisés et, dans l’impossibilité de se tenir constamment à hauteur du modèle, on doit se contenter, pourtant, de la plus vague des critiques impressionnistes.
Eliot, par sa poésie, touche les gens que ses théories rebutent le plus. Personnellement, nous ne nous sentons guère attiré vers quelqu’un qui formule sur lui-même des définitions de ce genre : « ma position est celle d’un catholique en religion, d’un royaliste en politique et d’un classique en littérature », ou qui, descendant dans l’arène, déclare : « pour ma part, une bonne politique implique une bonne théologie, et une économie aine est en fonction directe d’une ne. Consciemment et volontaire- bonne morale ».
Ses théories poétiques, elles-mêmes vont à contrecourant des conquêtes de la poésie moderne qui a voulu être voyance et connaissance, « dérèglement des sens », création d’émotions nouvelles, vie véritable substituée à la vie quotidienne, cri d’amour, de haine ou de désespoir, prophétie : « L’affaire du poète, écrit Eliot, n’est pas de trouver des émotions nouvelles, mais d’utiliser les émotions courantes, et, les œuvrant poétiquement d’exprimer des émotions qui ne se trouvent pas dans ses sentiment.
Une grande part de l’acte poétique doit être consciente et volontaire. La poésie n’est pas l’expression d’une personnalité mais évasion à partir de cette personnalité… »
Paul Valéry a dit quelque chose d’approchant et s’y est tenu. En ce qui concerne Eliot, ces déclarations n’ont aucune importance, sa poésie les faisant éclater sur toutes les coutures.
…
son langage qu’il voulu le plus près possible du langage parlé. C’est même en cela qu’il lait résider sa révolution poétique : user du parler commun, seul moule à un moment donné de la sensibilité d’une époque. Pour Eliot, il n’existe pas, a proprement parler de langage poétique, la prose la plus prosaïque devenant poésie pour peu que le poète l’anime de son rythme :
« La vaisselle du breakfast tinte dans [les sous-sols Et le long des trottoirs piétinés de la grue J’ai conscience que l’âme humide des [servantes Perce languissamment aux entrées de service…» (Matin à la fenêtre).
Poème au titre italien (Deux des trois strophes Traduit par Jean Wahl) :
LA FIGLIA CHE PIANGE (la fille qui pleure)
Tenez-vous sur la plus haute marche de l’escalier —
Penchez vous sur l’urne du jardin —
Tissez, lissez le rayon de soleil dans vos cheveux —
Serrez les fleurs sur vous avec une surprise douloureuse
Jetez-les vers le sol et détournez-vous
Avec un ressentiment fugitif dans vos yeux :
Mais tissez ; tissez le rayon de …
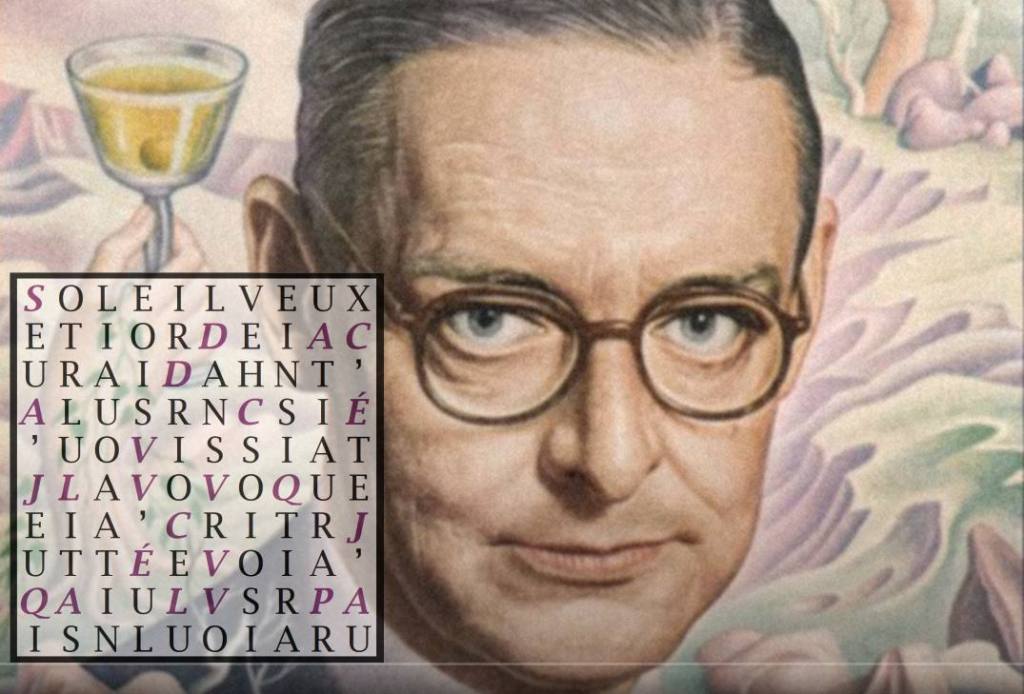
. … et pleurant,
C’est ainsi qu’il serait parti
Comme l’âme laisse le corps meurtri et déchiré,
Comme l’esprit laisse le corps dont il a usé.
Je trouverais
Une voie très légère et habile,
Une voie que nous comprendrions tous deux,
Simple et sans foi comme un sourire et un serrement de main
….
(Pour lire la grille plus facilement, cliquer ici)
Le poème en anglais, les trois strophes, lue ici par T.S. Eliot lui-même.

















