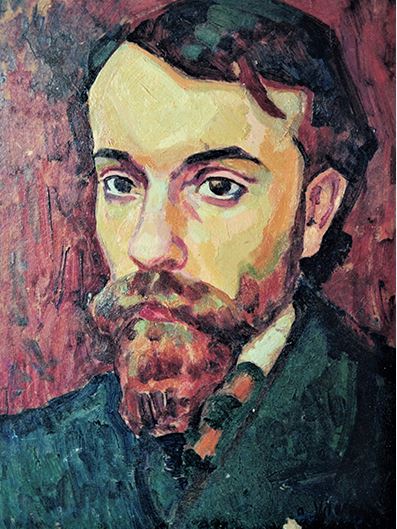… Christian Bobin, poète, (membre de la « Route Inconnue« *) « s’est éteint** ».
Télérama** dans le préambule de l’article que le magazine consacre à sa disparition en donne une courte présentation
« Bibliothécaire et guide de musée, l’auteur du “Très-Bas” vivait en homme tranquille, au Creusot. Goûtant la singularité sans cesse renouvelée d’un jour qui passe, d’un mot qu’on trouve. «
La dernière phrase de cette description aide à comprendre l’adhésion de Christian Bobin (membre d’honneur) à l’association des Amis d’André Dhôtel*
A la mort d’André Dhôtel Christiant Bobin a fait paraître un hommage dans la Nouvelle Revue Française, (titrée « « Je ne songe jamais à ce qui se passera plus tard » extrait de son livre « L’épuisement » … et empruntée à « Les chemins du long voyage » de Dhôtel), dont voici un extrait :
« Où êtes-vous, cher André Dhôtel, maintenant que vous êtes mort, où donc avez-vous élu domicile
(…)
Il me semble parfois que notre vie n’est faite que de ces premières gouttes et que le déluge ne tombera sur nos âmes qu’après le dernier jour, la mort venue. (…)
trois de vos livres. J’y ai retrouvé un goût d’adolescence, le désir contradictoire de parvenir vite au dernier mot et de ralentir l’allure des phrases, tellement on est bien dans la cabane d’encre, sous le feuillage d’une voix.
(…)
Aujourd’hui est le nom familier de la merveille. Aujourd’hui est éternel, vous savez bien.
(…)
Vous faites entrer de bien curieuses femmes dans vos songes.
(…)
Vos femmes d’encre ne sont pas d’encre mais de feu, d’eau et d’air. Au début du livre elles mettent le monde entier entre elles et un homme. À la fin du livre celui qui les cherche depuis la première phrase est enfin digne, fortifié par l’épreuve, de demander leur main.
(…)
vos livres, vous les écrivez pour amener l’homme à la hauteur de la femme, rude tâche, labeur infini.
(…)
La phrase est tracée d’une main ferme et on a pourtant l’impression que vous en êtes absent
(…)
Votre Bernard le paresseux a beau s’appeler comme ça, il n’y a vraiment qu’Estelle dans le livre, Estelle et sa rage lumineuse, protégeant une petite icône d’enfance.
Dans Le Village pathétique Julien est bien brave, assez fin pour un homme, il y a surtout Odile, Odile la solaire, aussi impitoyable et bonne que la meule du soleil sur les champs du monde.
Quant aux Chemins du long voyage, toute l’histoire est dans Irène, et toute Irène est dans cette phrase qu’elle dit de sa voix calme, sans doute en souriant, d’un sourire imperceptible :
« je ne songe jamais à ce qui se passera plus tard. »
(…)
Ah cher André Dhôtel, soyez béni pour avoir écrit de telles choses.
(…)
comme disent les enfants. Je ne sais pas s’il y a un «bon dieu ». S’il y en a un, je suis sûr qu’il partage votre émerveillement et votre stupeur devant ces femmes courant le monde, aux quatre coins de leur cœur : Estelle, Odile, Irène et leurs petites sœurs innombrables, tourmentées comme l’orage, insoucieuses comme l’amour. »
La transition est facile vers un texte (sa première partie) qui aurait plu à André Dhôtel et dont le titre est
Alina
Les berceuses sont pour les enfants. Qu’est-ce qu’un enfant ?
C’est un être de lumière que chaque soir et parfois même dans la journée on abandonne dans le noir.
Les berceuses sont les hymnes de cet abandon, en même temps qu’elles en sont l’antidote, le contrepoids sonore.
Dors, chuchote la voix tendre, le souffle au ras des fleurs, le pollen de l’âme maternelle.
Dors, entre dans le château sans porte ni fenêtres. Tu y seras plus seul qu’avant de naître et qu’après vivre, seul comme un tout petit dieu défunt.
Ma voix, cet air, cette chanson de toile sera ta nourrice dans les ténèbres.
Quand la petite lanterne japonaise de ton cerveau s’éteindra et que le fleuve noir rentrera dans tes veines, montera jusqu’à ton cœur, tu seras seul face à tes fantômes – et je serai encore là avec toi, dit la berceuse, la voix sacrée inconsciente de son règne.
(…)
Sur les paupières de soie des nouveau-nés, nous posons pour les sceller la pierre très blanche d’une berceuse. Elle pèse sans peser.
(…)
Les berceuses sont le pur alliage de la terreur et de l’amour. Les mères – les jaunes, les noires, les blanches – les mères de tous pays et de toutes époques se retirent sur la pointe des pieds où vient d’avoir lieu le meurtre par amour : le tout-petit livré aux ricanements des cauchemars et aux brigands de la faim, en même temps que rassuré, profondément rassuré par la persistance de la voix atténuée, la bonté assassine de la déesse aux bras roses.
(…)
Aucune voix aimée ne disparaît. (…)
Dors, mon bébé, dors. Tu n’es qu’un éclat sur la rivière et la rivière est sans fin, intarissable son chant. Celle que tu aimas jadis ne tombera jamais dans ton passé, là où vieillissent tes jouets et tes idées. Sa voix est devant toi, autour, partout. Repose dans ce paradis.
(…)
Les berceuses raccommodent ces accrocs du néant, ces déchirures inévitables de la Voie lactée. Les berceuses ne mentent pas en mentant.
(…)
Nous avons inventé des machines qui règnent sur nos mains, nos yeux et notre cœur. …

… : elles poussent l’enfant en nous sur une balançoire invisible jusqu’à l’infini dont il ne reviendra pas.
La berceuse archaïque des mères a deux temps.
Un premier temps, l’éloignement. Ma voix se fait nuit pour t’accompagner dans la nuit. La douceur de ma voix ne cache pas les terreurs de l’abîme. Elle en vient.
Un second temps, la reprise, souvent celle, élémentaire, du refrain. Car je suis là, encore, je suis ce petit pois sauteur du refrain et le sourire qu’il te donne jusqu’au cœur sans cœur de la nuit qui te tue.
(…)
C’est une berceuse d’un genre étrange. Elle n’endort pas. Elle réveille. Un homme l’a inventée. Arvo Pärt abrite cet homme en lui. Il loge dans son cœur, il en sort comme le coucou de l’horloge suisse, compose deux notes, trois, puis rentre. Ce qui nous perd, c’est la richesse. La simplicité d’une robe, le cri d’un psaume, l’interpellation effrontée d’une rose de jardin – nous avons besoin de peu pour recevoir des nouvelles du ciel donc de nous-mêmes. La quasi-berceuse s’appelle Alina.
(…)
Alina, Alina. Ma poupée, mon chef-d’œuvre, ma future survivante. Reprends des forces. Dors. Si tu savais comme je t’aime, tu gagnerais le ciel sans passer par ta mort.